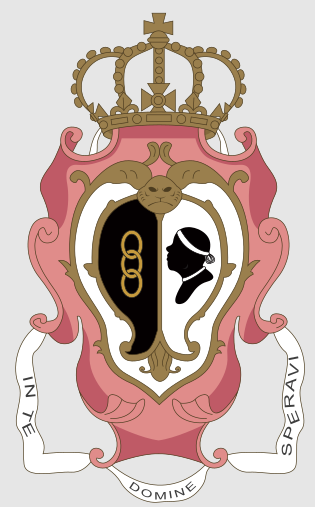TESTAMENT POLITIQUE DE THEODORE DE 1er, ROI DES CORSES
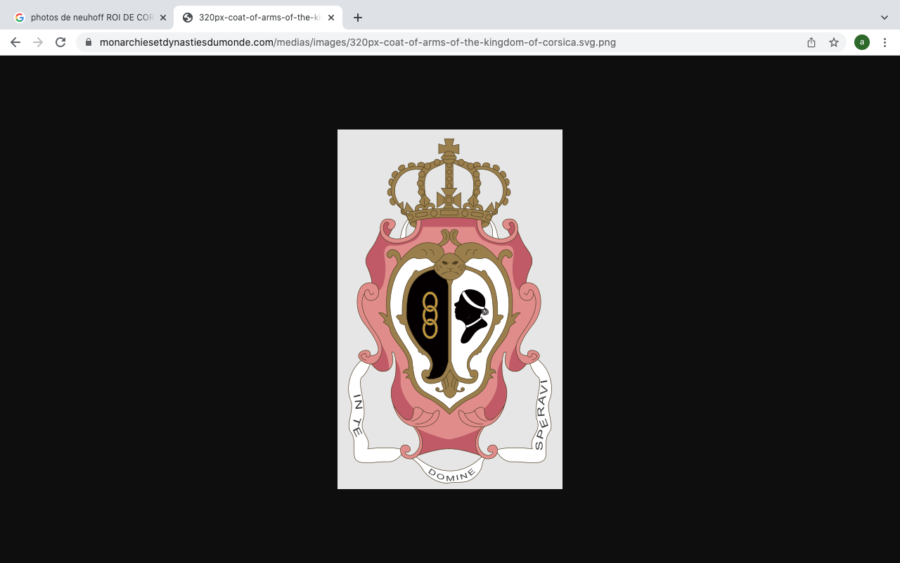
Conforme à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Extrait du TESTAMENT POLITIQUE DE THEODORE 1ER, ROI DES CORSES. Publié en 1895.
Neuhoff Théodore de 1694/1756. Document, écrit et signé de la main de Théodore.
THEODORE :
Théodore Antoine, baron de Neuhoff, naquit à Metz en 1690 ; il mourut à Londres en 1756. Son père possédait une baronnie dans le canton de Marck (Westphalie) ; il avait été capitaine des gardes de l’évêque de Munster ; mais, s’étant marié avec la fille d’un marchand, il fut disgracié et se vit obligé de se retirer en France, où la duchesse d’Orléans, lui fit obtenir le commandement d’un fort dans le pays Messin.
A sa mort (1695), son fils, Théodore Antoine, dut admis très jeune parmi les pages de la duchesse d’ORLEANS Il en sortit à 17 ans et entra en qualité de lieutenant dans le régiment de la Marck, au service de la France ; mais il n’y resta que peu de temps. Son esprit aventureux et son ambition précoce le firent passer dans l’armée Impériale, de là en Espagne, ou le cardinal Alberoni l’employa à comploter le rétablissement des Stuart sur le trône d’Angleterre.
Il resta à la cour de Madrid avec le titre de colonel honoraire, et fut chargé par le cardinal Alberoni de diverses missions diplomatiques. Après la chute de ce ministre, il resta en faveur auprès de son successeur, le duc de Riperda.
En Espagne, comme en Angleterre et en Italie, il contracta de grosses dettes qu’il ne paya jamais. Partout il chercha à inspirer confiance en se donnant des titres peu authentiques, tels que celui de chargé d’affaires de l’Empereur Charles VI.
1
Des émigrés corses avaient connu Théodore à Florence, en 1732 ; ils crurent trouver en cet homme lié de connaissance avec presque toutes les cours d’Europe, en cet homme habile, entreprenant, un chef capable d’assurer l’indépendance de la Corse. Ils lui offrirent la couronne, par l’entremise de l’abbé Orticoni.
Théodore accepta l’offre des Corses, et cela fait, il parcourut l’Europe, demandant à toutes les Cours des secours qu’il n’obtint pas. Il passa ensuite à Tunis, où il vit le bey, qui lui accorda, en vue du succès de son entreprise, des secours considérables. Théodore arriva en Corse, le 12 mars 1736, et fut reçu par les Corses comme libérateur ; il fut porté en triomphe au château de Cervione, ou il installa sa petite Cour.
Aussitôt après il attaqua les Génois et les battit dans deux rencontres. L’enthousiasme ne connut alors plus de bornes, et la Consulta générale convoquée le 15 avril à Alésani, l’élut à l’unanimité Roi des Corses, sous le titre de Théodore 1er. Le nouveau roi obtint de nouveaux succès ; mais l’argent s’épuisant et les secours demandés n’arrivant pas, Théodore se rendit à Livourne, Rome, Paris, Amsterdam. Il éveilla partout une grande curiosité, obtint quelques secours et débarqua de nouveau en Corse, le 15 septembre 1738. Il avait avec lui 3 vaisseaux portant 174 canons, plusieurs chaloupes-canonnières, une petite flottille de transports renfermant 24 pièces de campagne, 9000 fusils ou pistolets, 50 000 Kilos de poudre, 100 000 kilos de plomb. Théodore trouva le pays divisé et découragé ; le peuple conduisit cependant de nouveau son roi en triomphe à Cervione. C’est à ce moment que se produisit l’intervention française, à laquelle le peuple avait été préparé par les partisans d’une annexion de l’Ile de France. La vérité sur Théodore s’étant faite, les Corses ne virent plus dans ce personnage qu’un aventurier aux moyens douteux ; ils cessèrent de croire en lui et aux alliances qu’il faisait miroiter à leurs yeux.
Abandonné de ses sujets, il abdiqua er se retira à Londres.
On a parlé assez longtemps de moi dans le monde pour que je puisse supposer que l’on sera bien aise de me connaître. Je me propose cependant un but utile et plus glorieux que la vaine satisfaction de détruire les faux préjugés que mes ennemis et mes envieux ont rependu en Europe.
Ma vie est si mêlée d’événements de la bonne et de la mauvaise fortune, qu’un tableau exact de la façon dont je me suis conduit dans les principales circonstances où je me suis trouvé ne peut être que très instructif.
Les princes et le commun des hommes y verront des leçons également importantes ; ceux qui liront ces mémoires, avec un esprit libre de c, apprendront à mieux juger de moi, des peuples dont j’aurais fait le bonheur, et regretteront, peut-être, que je ne sois plus en état d’exercer des droits confiés aussi librement, qu’enlevés avec légèreté.
On aurait tort de regarder cet ouvrage comme une apologie intéressée de ma conduite : je ne dois qu’à mon bonheur et à ma gloire cette espèce de justification. Bien loin de me livrer aux espérances vagues d’une ambition que tant de malheurs ont limitée, je n’aspire plus qu’à finir paisiblement ma vie, dans un repos que je regardais, il y a trente ans, comme une espèce d’anéantissement.
Choisi par les suffrages empressés d’une nation qui rentrait dans l’exercice de ses droits, par l’abus que ses maîtres avaient fait des leurs, je n’ai point balancé sur l’offre d’une couronne où m’appelaient les voeux de la Corse opprimée. j’ai osé prendre rang parmi les souverains, et, si la fortune avat poursuivi son ouvrage, j’aurais occupé un trône, sur lequel ma postérité serait assise avec justice.
On a eu des idées bien diverses sur ce qui me regarde : mon pays, mon état et mes premières occupations ont été la matière des plus ridicules jugements. Je vais débrouiller ce chaos et paraître tel que je suis ; la vanité n’a aucune part dans les détails où je me crois obligé d’entrer. On ne me soupçonnera pas de vaine gloire dans ce que je dirai de ma naissance, du point d’élévation où je me suis vu. Les objets du petit amour-propre de la plupart des hommes ne me paraissent que ce qu’ils sont ; du reste les révolutions surprenantes de ma fortune m’ont appris à apprécier des grandeurs bien plus éblouissantes.
Je suis issu d’une famille noble, et né dans un pays où le préjugé de la naissance est un avantage trop réel pour ne point régner avec empire.
Mes ancêtres ont toujours tenu rang assez considérable dans le cercle de Westphalie ; mon père, dévoué de tout temps à la maison Palatine, suivit l’empereur Maximilien de Bavière, dans les événements qui ont bizarrement diversifié le cours de la vie de ce bon prince.
Je vins au monde pendant son attachement aux intérêts de l’Electeur de Saxe, au mois de janvier 1690. Je n’entrerai pas dans le détail des événements qui se sont passés dans mon enfance, même de deux auxquels un âge plus mûr m’a permis de prendre part. On a tant de mémoires sur ce qui s’est passé dans les dernières années de ce siècle, et l’on est si fort instruit des opérations militaires et politiques qui suivirent la mot de Charles second, roy d’Espagne, que tout ce que je pourrais dire ne serait qu’une ennuyeuse répétition.
Je me borne donc aux choses qui me sont personnelles, et, si quelquefois je suis obligé de parler des événements publics, c’est toujours dans le rapport qu’ils ont à mes affaires particulières.
A peine la paix de Rastadt avait-elle rétabli Maximilien dans la possession de son électorat, que ce prince me donna des preuves de l’estime qu’il avait pour mon père. Je passais, promptement, d’une compagnie du régiment de ses gardes au commandement du régiment du régiment d’Infanterie du Prince électoral. Je restais deux ans à la Cour de Bavière avec assez de tranquillité ; je faisais assidûment ma cour à Maximilien et à la Maison électorale. Je songeais à me marier ; mais une plus forte passion réveilla des idées de gloire et de fortune auxquelles il ne me fut pas possible de résister ; et, croyant ne différer mon mariage que de quelques mos, je me vis peu à peu dans la nécessité de n’y plus songer pour longtemps.
Le calme de la paix de Rastadt fut troublé par l’invasion subite que les Turcs firent en Morée, qui attaquèrent quelque temps après l’ile de Corfou ; l’Empereur, obligé de secourir les Vénitiens, se termina à la guerre ; M. le Prince Eugène en eut la conduite en Hongrie. J’aurais fort souhaité partager la gloire des deux princes en campagne ; mais il ne me fut possible de joindre l’armée qu’au printemps de 1717. M. le Prince Eugène venait d’investir Belgrade ; le grand-vizir ayant ramassé toutes les forces ottomanes m’archait pour nous en faire lever le siège.
Tout le monde connait la situation de Belgrade. Il était impossible au général de l’Empereur d’étendre son quartier de façon à embrasser tout le contour de la place ; le confluent du Danube et de la Saxe rendait cette position par trop hasardeuse. Il se borna donc à établir son armée entre les deux rivières, et à veiller sur les autres côtés de la ville par de fréquents détachements de cavalerie et de troupes légères. A peine le siège était il formé que l’approche du grand-vizir avec une armée de 200.000 homes nous annonça que nous n’achèveront pas le siège de Belgrade sans combattre.
Le comte de Mérit, tué depuis à la bataille de Parme, fut détaché avec un gros de cavalerie de de grenadiers pour observer les mouvements des Turcs ; il disputa pendant quelque temps les premiers débouchés à l’avant garde de leur armée, et quand il crut avoir pénétré que leur dessein était de s’approcher de notre camp, il marcha en retraite avec beaucoup de conduite et d’audace.
Les Turcs vinrent se poster à une lieue et demie de distance de notre camp, sur les hauteurs qui le bordaient ; lr front du terrain qu’ils occupaient était assez resserré. Le grand Vizir eu l’imprudence de se camper sur plusieurs lignes dédoublées, faisant face au Danube et à la saxe, Ce qui pouvait s’exécuter sans nous prêter le flanc dans toute l’étendue de sa position. Un large canal était plus près d’eux que de nous. Il n’y eut qu’une voix dans toute l’armée pour attaquer les infidèles dans une position qui nous parut si vicieuse ; mais ce cri universel n’ébranla pas M. le Prince Eugène, qui avait des idées plus élevées. Il sentit que les Turcs seraient forcés de joindre une plus grande faute à cette première démarche, et il attendit ce moment qui ne manqua pas d’arriver.
Je m’entretenais un soir avec M. le Prince Eugène de l’envie que l’armée témoignait de combattre, et de la belle occasion que les Turcs paraissaient nous offrir ; il répondant à mes raisons, avec cette bonté qui lui était naturelle, mais sans me découvrir son projet ; mais lorsque M. le Prince Alexandre Wurtemberg entra : “Monsieur, lui dit-il, ne voulez-vous pas détruire demain toutes les forces du Sultan ?”
– “Et comment cela ? répondit Eugène”.
-“Croyez-vous la chose si facile ?”
– ” Sans doute, répliqua M. de Wurtemberg, il ne faut les attaquer que dans leur camp ; il est plus mal choisi que ceux d’Hoestet et de Turin.”
Ces deux premiers princes eurent devant moi une discussion pendant laquelle l’un s’abandonna à toute l’impétuosité de son carctère, et l’autre ne sortit jamais des bornes de la douceur. Il feignit enfin de se rendre, en disant à M. de Wurtemberg que le lendemain il consentait à examiner avec lui les positions de l’ennemi et les raisons qui pourraient faire espérer de les attaquer avec succès.
Lorsque le Prince Alexandre fut sorti, notre général me dit qu’il était persuadé que je changerais d’opinion, et que la nécessité de donner une bataille ne me paraîtrait pas aussi pressante que dans ce moment.
Les officiers généraux se rendirent de bon matin chez M. le Prince Eugène. Un gros détachement aux ordres du Comte de Kenhllar précéda et couvrit la marche ; on repoussa les gardes des Turcs, on suivit tout le front du champ de bataille qu’ils avaient choisi, et on rejoignit l’armée, plus persuadés que jamais qu’il fallait combattre.
En effet, jamais armée ne s’est trouvée dans une situation plus critique que celle où nous étions. L’arrivée du Vizir avait relevé le courage et les espérances des assiégés ; notre armée était. fort diminuée, nos subsistances ne pouvaient plus aborder par le Danube, la flotte des Turcs, supérieur à la notre, et l’artillerie de la place nous enfermaient dans notre camp ; de plus 60 000 Tartares, qui couraient le pays, rendaient toutes routes impraticables à nos convois.
Je soupais chez M. le Prince Eugène, qui paraissait résolu de tenter la fortune, lorsuqe sur le point de me retirer, il dit au Comte de Mérit de m’amener dans son cabinet et de l’y attendre avec moi.
“- Vous croyez, nous dit-il, en y rentrant, que je me suis rendu, mais vous vous trompez. Ecoutez mes raisons, pesez les ; après, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez pu remarquer l’amas de fascines que les Turcs font dans leur camp ; il est facile d’en deviner l’usage ; ils se préparent à nous attaquer dans le nôtre. Je suis bien éloigné de les en empêcher, car ils ne sauraient venir à nous qu’en traversant le ravin qui va de la Xaxe au Danube. Or, ce ravin est trop près de notre camp pour qu’ils puissent songer à se poster tous en deçà. Ils se mettront entre leurs lignes, ils seront donc réellement séparés en deux, et je les combattrai dès qu’ils auront fait ce mouvement, avec l’avantage de n’avoir en tête qu’une parie de leurs forces, et s’ils passent en totalité le canal, ils seront encore dans la nécessité de se voir attaquer dans un poste sans profondeur, où tous leurs mouvements seront gênés ; ajoutez à ces difficultés un obstacle presque invincible à leur retraite, ce qui est un inconvénient bien capital pour des troupes sans discipline, et qu’on ne rallie jamais.
” Cependant dans le cas où le Vizir s’obstinerait, ce que je ne crois pas, à me bloquer en se tenant dans le camp qu’il occupe, je serais alors contraint de revenir à l’avis de M. le Prince de Wurtemberg ; mais vous sentez bien que pour me procurer les avantages qui résulteront des faux mouvements où j’espère engager le Turcs, il n’est pas juste de suivre les conseils que le courage et l’envie de se signaler dictent à M. de Wurtemberg et à toute l’armée. Cette ardeur me charme, j’en tire bon augure pour le succès ; mais je n’en veux faire usage que dans les règles de la guerre er de la prudence.”
Il faut les talents de M. le Prince Eugène pour parler avec cette éloquence militaire et persuasive qui lui était propre. Il entra avec nous dans le détail de tous les mouvements possibles des Turcs relativement à ses desseins. Après avoir sa patience et sa sagesse.
Que sert de s’étendre plus au long sur un évènement encore récent, et dont le souvenir ne périra jamais ! J e ne suis reste entré dans le détail de ce qui précède cette glorieuse journée que pour justifier M. le Prince Eugène du reproche de timidité dont quelques envieux ont osé taxer la plus belle et la plus prudente action de ce grand capitaine. Les Turcs donnèrent également dans tous les pièges qu’il leur tendit ; il les amena au point où il voulait les combattre, ce qu’il fit enfin avec une gloire et un succès prodigieux.
Ce prince me fit l’honneur de me distinguer entre ceux dont il parut content après cette importante victoire. Et il écrivit, si favorablement pour moi, à Vienne et à Munich, que je n’ai pas manqué de ressentir les effets de son estime dans une affaire qui changea absolument mes desseins et ma fortune.
Le marquis Mattei commandait les troupes bavaroises, et avait sous lui un maréchal de camp, nommé La Colonie, qui a publié ses mémoires.
Ces deux généraux étaient ouvertement mal ensemble. Je n’étais lié avec aucun d’eux.
Après la bataille, pendant laquelle le marquis Mattei se conduisit en brave, La Colonie répandit sourdement que le général bavarois n’avait pas fait son devoir. Cette accusation fit du bruit. Un jour que je dinais avec La Colonie chez M. le Comte Jean Palsi, La Colonie eut l’impudence de dire que le marquis Mattei n’avait paru à la tête de nos troupes que lorsque tout était fini. Une si fausse accusation me révolta : Je répondis que pendant toute la bataille j’avais vu Mattei à son poste, remplissant ses devoirs en honnête homme et qu’il m’avait même donné plusieurs ordres pendant l’action et dans les moments les plus périlleux.
Il me répondit brusquement que je mentais ; à quoi je répliquais comme l’exigeait l’insulte : nous nous battîmes. Je blessais La Colonie d’un coup de pistolet, dont il ne mourut cependant pas.
Une pareille aventure ne saurait être regardée comme pardonnable dans un pays où le poids de la subordination étouffe tout préjugé de délicatesse et de point d’honneur.
La Colonie était un brave et de plus mon supérieur ; il avait bien servi la maison de Bavière et contribué avec assez d’éclat à la victoire de Belgrade. Je l’avais offensé irrémissiblement par un affront dont le sentiment n’est pas si vif en Allemagne qu’en France ; et, au m’épris de l’obéissance que je lui devais, je m’étais battu avec lui. Je sentis que je ne pouvais plus rester au service de l’Electeur de Ba vière et je me déterminais à l’en prévenir.
Je fus quelque temps incertain du parti que je prendrais ; mais mon goût pour la guerre ne me permit pas de rester oisif. Je balançais un moment pour la France, et je me déterminais enfin pour l’Espagne.
Le cardinal Albéroni était alors tout-puissant à Madrid. Cet homme, d’un esprit élevé et incapable d’être rebuté par des difficultés, avait conçu le vaste projet d’ébranler l’Europe pour rejoindre à l’Espagne ce qu’elle avait été contrainte de sacrifier pour le bien de la paix. Il communiqua à tous les ordres de l’Etat l’activité de son génie ; il imprima une énergie jusqu’alors inconnue à tous les ressorts de ce gouvernement, de sorte qu’en moins de trois ans, on vit l’Espagne, qui n’avait pu réduire seule les rebelles de Catalogne, enle ver la Sardaigne, attaquer la suisse, troubler la France et l’Angleterre par des intigues, relever les espérances de la Suède, et attirer, dit-on les Turcs en Hongrie.
Une nombreuse armée fut formée en peu de temps, des flottes redoutables sortirent des ports de cette monarchie abattue et épuisée. Tant il est vrai qu’il n’y a rien d’impossible à un grand génie absolu dans un puissant Etat. Je pris la route de Madrid en refusant de me chargée de lettres de recommandations une simple permission de l’Empereur et une lettre de M. le prince Eugène me parurent suffisantes.
Voici cette lettre :
” A Belgrade, le 18 septembre 1717.
J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire. Je n’abuserai pas de la confiance que vous me témoignez ; j’y suis sensible et vous savez que je la mérite par mes sentiments pour vous. J’ aurais grande envie de vous retenir au service de l’Empereur ; mais les égards que sa Majesté Impériale doit à M. l’Electeur de Bavière s’opposent à ma bonne volonté. Soyez sùr que dans quelques pays que vous habitiez, je ne cesserai de vous aimer et de vous estimer ; il ne m’est pas possible de vous recommander en Espagne, car je n’y suis connu que par des lettres dont je ne dois pas faire usages. La circonstance d’ailleurs n’est nullement favorable ; mais le cardinal Alberoni se connaît trop bien en hommes pour ne pas voir ce que vous valez.
Si mon estime parfaite peut contribuer à votre fortune vous pourrez assurer tout le monde qu’on ne peut rien ajouter à celle que j’ai pour vous.
Je vous prie d’en être persuadé ,ainsi que des sentiments avec lesquels je suis, Monsieur, votre très affectionné serviteur, Eugène de Savoie.
A peine fus-je arrivé à Madrid, que je cherchais l’occasion de me faire présenter au cardinal Albéroni. L’occasion ne tarda pas : L’abbé Albéroni, son neveu, se chargea de me rendre ce bon office.
Vers la fin de novembre 1717, la Cour était alors à Madrid. Je fus introduit dans le cabinet de ce ministre sans le cérémonial dont les cardinaux sont rarement avares. il se leva quand il me vit entrer, et me dit obligeamment qu’il savait tout ce que je valais, que le roi faisait cas du courage et de la conduite, et qu’il était persuadé que mes services justifieraient la réputation qui m’avait précédé à Madrid…………..Pg19